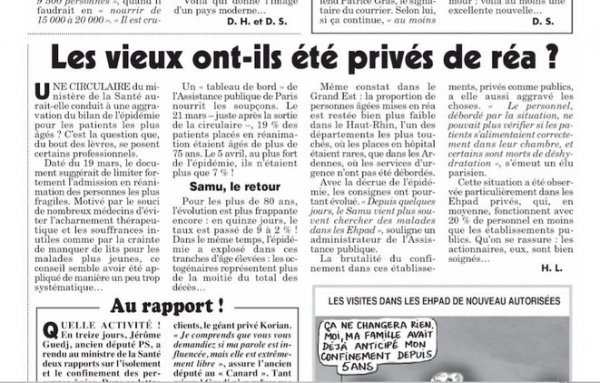Un avis important du Comité Consultatif National d’Ethique concernant les mesures de protection dans les EHPAD et les USLD.
Edit Printemps 2021 : Avec un peu de recul, on peut noter que les équipes de nombreux établissements ont réussi à suivre ces recommandations, mais qu’en revanche aussi bien le gouvernement que le ministère concerné et les ARS les ont le plus souvent absolument ignorées et méprisées.
30 mars 2020
CCNE – Réponse à la saisine du ministère des solidarités et de la santé sur le renforcement des mesures de protection dans les EHPAD et les USLD
Monsieur le Ministre,
Par une saisine du 25 mars 2020, vous avez souhaité recueillir l’avis du CCNE sur la question du renforcement des mesures de protection dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et les unités de soins de longue durée (USLD). Dans le contexte d’état d’urgence sanitaire, qui s’accompagne de mesures restrictives des libertés publiques et individuelles, le CCNE est donc sollicité pour apporter un éclairage éthique sur la question suivante : « Au regard de ses avantages sur le plan de la santé publique mais aussi des conditions à mettre en œuvre pour garantir le respect du confinement par les résidents, y compris les résidents atteints de troubles cognitifs, une décision nationale de confinement préventif de l’ensemble des résidents paraît-elle justifiée ? Si oui, quels garde-fous devraient être prévus par le Gouvernement ? »
Au préalable, il conviendra de noter que la réponse à cette saisine, attendue dans des délais très courts compte tenu de l’urgence d’une prise de décision en la matière, est difficilement compatible avec une réflexion éthique approfondie qui suppose un regard pluridisciplinaire sur la question posée et la possibilité d’un dialogue confrontant des opinions pouvant être différentes.
Néanmoins, malgré ce temps court, le CCNE a rapidement mis en place un groupe de travail1 qui s’est réuni le 27 mars 2020, puis a élaboré un projet de lettre de réponse transmis, dans la même journée, à l’ensemble des membres du CCNE, et discuté avec eux.
La présente réponse synthétise ces discussions en assumant une modestie délibérée dans les circonstances actuelles. Il s’agit pour le CCNE de proposer quelques repères simples : (1) rappeler les avis et principes éthiques les plus généraux ; (2) prendre avec toute la modestie requise la pleine mesure de la situation d’urgence actuelle, notamment pour les soignants ; (3) évoquer quelques pistes concrètes pour le respect des principes dans ce contexte particulier.
Le CCNE a été amené à se prononcer à plusieurs reprises sur les enjeux éthiques liés à la prise en charge de patients en cas de pandémie, dans son avis 106 de 2009 sur « Les questions éthiques soulevées par une possible pandémie grip- pale » et dans sa contribution récente du 13 mars 2020 sur « Enjeux éthiques face à une pandémie ». Par ailleurs, dans son avis 128 (Enjeux éthiques du vieillissement, 2018), le CCNE avait interrogé le sens de la concentration des personnes âgées entre elles dans des établissements dits d’hébergement.
Enfin, un travail de veille réalisé durant la gestion de la crise COVID-19 concernant les personnes vulnérables du fait de l’âge, du handicap ou de l’état psychiatrique avait dégagé les problématiques éthiques relatives à la rupture de la relation en raison du confinement et de l’interdiction de visites des familles en EHPAD2, le risque affectif de l’isolement, d’une séparation absolue d’avec les autres, en particulier d’avec la famille et les personnes significatives pour chacun, s’ajoutant alors au risque épidémique.
Au regard de ces travaux et dans le contexte actuel, le CCNE rappelle que les principes éthiques fondamentaux doivent être respectés. L’urgence sanitaire peut justifier que des mesures contraignantes soient, à titre exceptionnel et temporaire, exercées pour répondre à la nécessité d’assurer la meilleure protection possible de la population contre la pandémie, mais cette situation d’urgence ne saurait autoriser qu’il soit porté atteinte aux exigences fondamentales de l’accompagnement et du soin, au sein de l’établissement ou en structure hospitalière. Le respect de la dignité humaine, qui inclut aussi le droit au maintien d’un lien social pour les personnes dépendantes, est un repère qui doit guider toute décision prise dans ce contexte où les équipes soignantes et administratives, ainsi que les auxiliaires de vie, dont le dévouement exemplaire est à juste titre souligné par tous, sont de plus en plus confrontés à des situations dramatiques. Ces situations engendrent aussi des risques croissants pour eux-mêmes et leurs proches, qui enferment les soignants dans ce dilemme : se dévouer pour soigner, avec le risque pour soi-même et les autres d’être infecté par le soin que l’on prodigue.
Le CCNE avait déjà alerté, dans son avis 128, de la situation parfois difficile que rencontraient les personnes âgées dans les établissements d’hébergement. La crise sanitaire actuelle est révélatrice du manque de moyens préexistants, notamment humains, dans ces établissements. La pénurie de personnels et des ressources indispensables aujourd’hui (masques de protection, tests de détection), dans un contexte d’isolement déjà installé, exacerbe les difficultés auxquelles les professionnels de santé doivent faire face dans l’urgence.
Toute mesure contraignante restreignant les libertés reconnues par notre État de droit, notamment la liberté d’aller et de venir, doit être nécessairement limitée dans le temps, proportionnée et adéquate aux situations individuelles. Elle doit être explicitée aux résidents, aux familles et aux proches-aidants, et soumise à contrôle.
Un renforcement des mesures de confinement pour les résidents des EHPAD et des USLD, voire des mesures de contention pour ceux dont les capacités cognitives ou comportementales sont trop altérées pour qu’ils puissent les comprendre et les respecter, ne saurait être décidé de manière générale et non contextualisée, tant la situation des établissements diffère.
Le CCNE rappelle vivement que l’environnement familial ou amical dont les résidents ne peuvent plus momentanément profiter est, pour nombre d’entre eux, le lien qui les rattache au monde extérieur et leur raison essentielle de vivre, comme en témoignent de façon unanime les professionnels de terrain. Les en priver de manière trop brutale pourrait provoquer une sérieuse altération de leur état de santé de façon irrémédiable et même enlever à certains le désir de vivre. La prise de conscience de cette situation est aussi de nature à causer à leurs proches une souffrance majeure à laquelle il faut être particulièrement attentif.
Avant toute prise de décision au cas par cas et pour tempérer la rigueur incontestable des mesures d’isolement et de contrainte, tous les moyens (humains et ressources) doivent être identifiés et mobilisés, dans chaque établissement : personnels disponibles, y compris dans l’environnement de l’établissement, utilisation contrôlée de locaux disponibles et d’espaces extérieurs ou de loisirs, recours aux nouvelles technologies de communication numérique, dans le respect des règles générales de prévention.
Le déploiement rapide de moyens humains nécessaires pour remplacer les professionnels arrêtés pour maladie afin que les soins de base (se nourrir, se laver, se déplacer) soient toujours assurés, ainsi que des moyens supplémentaires (par exemple, pour assurer la protection sanitaire et l’accompagnement) est nécessaire en ce domaine, en n’omettant pas de prévoir des moyens humains nouveaux en compétences, pour faciliter des médiations à distance entre la famille et les résidents confinés, ainsi que la présence de volontaires bénévoles, souvent indispensables pour permettre, par exemple, l’utilisation effective des nouvelles technologies par des populations qui n’en ont pas toujours la maîtrise, s’agissant des résidents comme des personnes de l’environnement familial.
A titre d’exemple, l’espace de liberté laissé aux résidents, nécessairement variable selon les établissements, et au sein même de chacun d’entre eux, pourrait se traduire par l’organisation de secteurs séparés, les uns réservés à l’accueil de personnes chez lesquelles la recherche de l’infection par le COVID-19 s’est révélée positive, les autres aux résidents non atteints, mais pour lesquels un dépistage régulier permettrait de réévaluer périodiquement le statut infectieux de la personne.
La préservation d’un espace de circulation physique, même limité, nous semble impératif en dépit des mesures d’isolement, afin d’éviter que le confinement, quelle que soit sa justification au regard des impératifs de santé publique, ne devienne pour ceux qui n’ont plus la liberté de choisir leur cadre et leur mode de vie, une mesure de coercition.
Pour les résidents « testés négativement », la visite de proches, eux-mêmes contrôlés négativement, pourrait être autorisée, dans des conditions strictes de sécurité sanitaires. Cette proposition exige évidemment que des tests puissent être proposés à grande échelle.
Concernant les familles et les proches aidants qui souhaitent que le résident puisse au moins temporairement les rejoindre à leur domicile, de telles initia- tives devraient être encouragées, après avoir bien entendu recueilli l’assentiment du résident et pratiqué des tests permettant de prévenir des risques de contamination intrafamiliale. Une aide appropriée devrait être apportée à ces familles pour leur permettre de dispenser les soins nécessaires. Ces préconisations ne peuvent être mises en œuvre que si les établissements disposent de la possibilité d’assurer les tests de dépistage du COVID-19 auprès des personnels et des résidents.
Le CCNE rappelle donc l’impérieuse nécessité de faciliter la mise en place des tests de dépistage dans ces établissements et l’accès aux moyens de protection pour le personnel, comme pour les résidents.
Enfin, un accueil organisé pour les familles et les proches aidants, parfaitement régulé et sécurisé avec les protections qui s’imposent, pourrait également être envisagé, en particulier pour les résident(e)s en fin de vie.
Concernant plus particulièrement les personnes présentant des troubles cognitifs, vouloir leur imposer un confinement est extrêmement complexe, pouvant engendrer d’autres risques, notamment la décompensation psychique. Comment imposer une mesure de restriction des libertés qui ne peut pas être comprise, entre autres parce que les enjeux ne peuvent pas être mémorisés ?
Les mesures de santé publique et de confinement reposant sur le principe de la compréhension, par chacun, de ces dynamiques de solidarité, qu’en est-il des per- sonnes qui ne sont plus en état d’assumer leur propre responsabilité, mais qui vivent encore à domicile ou en établissement ouvert (résidence autonomie, EHPAD hors secteur fermé) sécurisé par la routine soignante instaurée au quotidien, désorganisée aujourd’hui par défaut de soignants ? Faudra-t-il aller jusqu’à contraindre ces personnes en leur appliquant des mesures de contention, physique ou pharmacologique ? La réponse à cette question complexe est loin d’être évidente, mais pour chaque situation, cette question doit être posée et la réponse élaborée en fonction du contexte spécifique. Elle doit être surtout le fruit d’une discussion préalable, interdisciplinaire et collégiale, associant des échanges avec des personnes extérieures à l’institution, comme les professionnels des équipes mobiles de gériatrie, ainsi que les proches, sans jamais oublier que l’on peut nier l’humanité de la personne en niant le sens qu’a sa déambulation.
Tout renforcement des mesures de confinement doit ainsi être décidé par le médecin coordonnateur et le directeur de l’établissement, en lien avec les instances et tutelles dont ils dépendent. Il doit être adapté aux capacités de chaque établissement, avec une information, constamment tracée et en toute transparence, des mesures prises à l’adresse des professionnels de santé, des personnels et bénévoles des établissements, des usagers et de leurs familles et des proches aidants, ainsi que des citoyens.
Pour la mise en œuvre pratique de ces préconisations, le CCNE rappelle sa recommandation du 13 mars 2020 de mettre en place des cellules éthiques de soutien.
En vous assurant de notre disponibilité dans le cadre de notre mission consultative, veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre soutien.
Karine Lefeuvre
, Présidente par interim du CCNE.
—
Le rapport du CCNE en pdf :